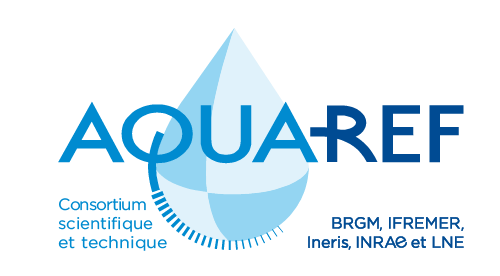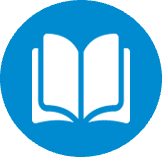Techniques innovantes
De nouveaux outils doivent être développés et mis en œuvre dans le but d’optimiser les programmes actuels de surveillance et d’améliorer les performances des méthodes, d’améliorer la représentativité des mesures ou d’anticiper la recherche de nouveaux types de perturbations. Le développement et la maîtrise de nouveaux outils d’échantillonnage intégratifs dans le temps permettent, par exemple, d’intégrer le suivi des concentrations de certains micropolluants dans les milieux aquatiques récepteurs et ainsi de mieux caractériser la contamination chimique d'un écosystème aquatique. L’utilisation de bioessais spécifiques basés sur le mode d’action des substances (par exemple la perturbation endocrine) permet de mettre en évidence la présence de certaines familles de substances sans rechercher une liste finie de composés. On parle alors de bioanalyse. Les démarches d’analyse non ciblées permettent d’acquérir en une seule analyse une caractérisation chimique très complète de l’échantillon d’eau (appelée empreinte chimique).
De même, de nouveaux concepts de bioindication, comme l’utilisation de l’ADN environnemental ou d’indicateurs biologiques de contamination toxique globale (caging) sont développés ou vont l’être dans un futur proche, pour préparer la surveillance de demain, dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre de la DCE au-delà de 2027.
La surveillance du milieu aquatique peut ainsi être envisagée sous d’autres formes que celles habituellement proposées dans les textes réglementaires relatifs à la surveillance surtout en termes de méthodes complémentaires.
Pour autant, les techniques alternatives doivent faire l’objet d’une attention aussi importante que les techniques « usuelles » en termes de validation de protocoles, de métrologie et encadrer clairement les performances de ces outils alternatifs. Il peut s’agir de la mesure de paramètres physico-chimiques ou de micropolluants in situ ou en continu, voire de méthodes complètement innovantes qui visent plus à mesurer les effets de manière à conjuguer par la mesure des effets, l’impact des mélanges de substances sur le biote.
Quelques méthodes importantes basées sur des principes nouveaux s’intègrent progressivement à la surveillance :
Échantillonneurs intégratifs passifs (Outils et méthodes innovants pour la détection ou la mesure des contaminants | Le portail technique de l'OFB) : ces dispositifs introduits dans le milieu pendant une semaine à 15 jours préconcentrent les polluants. Ils ont l’avantage en règle générale de diminuer les limites de quantification et de garantir une meilleure représentativité temporelle de l’échantillonnage que les échantillonnages ponctuels (classiquement appliqués pour les cours d’eau), en fournissant une concentration moyennée sur la durée d’exposition. Ces outils ont été testés au niveau national dans une étude de démonstration dans le cadre du réseau de surveillance prospective et ils ont été officiellement autorisés dans la surveillance des eaux de surface continentales par l’arrêté du 26/04/22. Leur utilisation concrète dans les programmes de surveillance est à venir.
Analyses non ciblées (spectrométrie de masse haute résolution) (Application screening non ciblé pour la surveillance prospective_Rapport Aquaref) : ces méthodes constituent une des évolutions majeures à venir au niveau analytique mais elles sont encore à un stade de recherche ou d’applications pré-règlementaires. De façon très schématique, elles permettent d’acquérir en une seule analyse une caractérisation chimique très complète de l’échantillon d’eau (appelée empreinte chimique). Cette empreinte chimique est enregistrée et stockée, et peut être traitée immédiatement ou a posteriori autant de fois que souhaité, afin d’identifier la présence de substances d’intérêt (répertoriées dans des bibliothèques très larges de substances), ou encore d’identifier des substances non connues sur la base de leurs spectres de masse. Le traitement de l’empreinte chimique a posteriori permet de révéler la présence de substances non recherchées à l’époque de l’analyse de l’échantillon (exemple d’études récentes sur les PFAS).
Bioessais (Biosurveillance environnementale | Le portail technique de l'OFB) : de nombreux contaminants chimiques sont présents dans les milieux aquatiques et ont des effets biologiques néfastes pour la faune et la flore avérés ou suspectés. La surveillance réglementaire de la qualité chimique des milieux est classiquement réalisée par la mesure de la concentration d’une liste finie de contaminants à l’aide de méthodes d’analyse chimique. Cette approche présente les inconvénients de ne surveiller que les contaminants ciblés par les méthodes d’analyse, de ne pas renseigner sur l’effet des contaminants, ni de prendre en compte leurs effets en mélange. Ainsi, en complément des méthodes d’analyse chimique, la surveillance des milieux peut être réalisée par des méthodes biologiques, appelées également bioessais. Ces méthodes permettent de mesurer l’effet biologique des contaminants présents dans les échantillons d’eau. Il existe différents types de bioessais (in vitro et in vivo), et qui permettent de renseigner différents types d’activité biologique (par exemple, activité œstrogénique, de type HAP ou de type dioxine). Les bioessais présentent plusieurs avantages. Ils permettent de déterminer l’activité de l’ensemble des contaminants (aussi bien connus qu’inconnus) d’un échantillon, ils permettent de tenir compte des effets de mélange, ils sont quantitatifs et peuvent quantifier l’effet des contaminants à de très faibles concentrations. En revanche, ils ne permettent pas d’identifier les substances actives, ce qui invite à utiliser les bioessais en complémentarité avec des méthodes d’analyse chimique.
Gammares : la biosurveillance via l’utilisation de gammares encagés a été développée pour répondre aux exigences de la directive cadre sur l’eau (DCE) en termes de suivi de la contamination chimique des cours d’eau. L’expérimentation in situ (encagement) permet de contrôler les organismes tests et la durée d’exposition, rendant possible une comparaison fiable des données obtenues entre stations et au cours du temps. Cet outil permet aujourd’hui de qualifier le niveau de contamination biodisponible des cours d’eau pour de grandes familles de composés chimiques (métaux, hydrocarbures aromatiques polycycliques : HAP, polychlorobiphényles : PCB et plusieurs pesticides dont certains sont interdits depuis longtemps mais que l’on retrouve toujours : DDT, Lindane) et d’identifier quelles sont les substances les plus problématiques. En complément, des bioessais in situ, utilisant aussi les gammares encagés, permettent d’évaluer la toxicité des cours d’eau à une échelle nationale. Ces outils sont basés sur l’étude des effets en réponse à la contamination chimique et accompagnés de grilles d’interprétation pour les différentes réponses biologiques (ou biomarqueurs) in situ. Ces outils sont aujourd’hui normalisés, déployés à l’échelle des réseaux DCE et permettent aux gestionnaires d’avancer dans l’identification des pressions toxiques qui s’exercent sur les écosystèmes aquatiques continentaux. Ces outils permettent également d'évaluer l'impact d’un rejet ou d'une pollution accidentelle sur le milieu naturel.
Les travaux d'AQUAREF portent essentiellement sur le développement des outils de validation de ces nouveaux systèmes, qu'ils s'agissent des échantillonneurs passifs, des mesures in situ ou en continu, de bioessais, d'analyse non ciblée ou de nouveaux types de bioindicateurs.