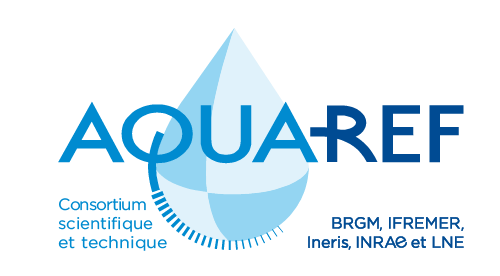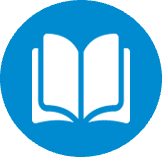Bioindication
La directive cadre sur l'eau, dans son annexe IV, prescrit une méthodologie d’évaluation de l’état écologique basée sur quatre éléments biologiques contributifs :
- le phytoplancton,
- les macrophytes et le phytobenthos,
- la faune benthique invertébrées,
- l’ichtyofaune.
Les méthodes développées par chaque Etat-membre sont soumises à un interétalonnage visant à assurer la comparabilité du classement de l’état des masses d’eau sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne. De même, l’interétalonnage valide la compatibilité aux normes européennes et aux prescriptions méthodologiques de la DCE, comme par exemple une évaluation de l'état basée sur un ratio écologique par rapport à une référence (EQR=qualité observée/qualité de référence).
A la mise en œuvre de la DCE en France, les méthodes de bioindication disponibles ne répondaient pas à ce nouveau contexte, puisqu'elles étaient inexistantes pour certains éléments biologiques ou non adaptées pour d'autres.
Dans ce cadre, la mission d'Aquaref est de :
- identifier les besoins méthodologiques,
- programmer et assurer le développement des protocoles,
- assister les opérateurs dans leur mise en œuvre, en produisant des documents d'encadrement technique et en assurant des formations professionnelles,
- produire des textes susceptibles d'être standardisés, et assister les pouvoirs publics dans la normalisation française et européenne.
Cette démarche a été initiée pour tous les éléments biologiques concernés par l'évaluation au sens de la DCE, ainsi que pour toutes les catégories de masses d'eau : rivières, lacs, estuaires, littoral. Ils se poursuivent par l’amélioration des indicateurs sur la base des données acquises depuis 20 ans et l’intégration de nouveaux concepts de bioindication (indicateurs multimétriques basés sur les traits écologiques, approches biomoléculaires utilisant l’ADN environnemental, etc.)
Ces travaux sont réalisés par INRAE pour ce qui concerne les eaux continentales et de transition (rivières, lacs, estuaires), et par l'Ifremer pour les eaux côtières.
║ En savoir plus sur la méthodologie DCE pour l'hydrobiologie
Les méthodes « estuaires »
Protocole d’échantillonnage du compartiment « ichtyofaune » pour les masses d’eau de transition dans le cadre de la DCE.
Ce protocole est pour l’instant un document technique INRAE en vue d’échantillonner le compartiment "poissons" des eaux de transition françaises. A la suite d'une étude préliminaire nationale réalisée en 2005/2006, l'INRAE a mis en place ce protocole standardisé qui sera utilisé en routine dès 2009 sur la totalité des estuaires retenus de la façade Manche Atlantique (l’échantillonnage ne commencera qu’en 2010 en Méditerranée).
Ce protocole définit :
- la liste d’estuaire à échantillonner,
- le choix des stations d’échantillonnage,
- la méthode de pêche (pêche au chalut à perche, avec des traits de 15 minutes, contre le courant),
- l’effort d’échantillonnage adapté à chaque estuaire et l’engin utilisé (8 traits de chalut par zone haline, utilisation d’un chalut de 3m pour les grands estuaires -Seine, Loire et Gironde-, 1.5m pour les autres),
- la méthode de traitement des captures (détermination, comptage, mesure à la fourche, pesée individuelles des individus de plus de 50g, poids total par espèces pour les autres),
- la méthode de saisie sur des modèles standardisés établis par le Cemagref.
A l'heure actuelle, INRAE est en charge de la validation, de la bancarisation et du traitement des données. Pour ces traitements, un système de métriques basé sur les guildes écologiques (ensemble d’espèces ayant une fonctionnalité semblable) permet de définir pour chaque métrique un état (bon, moyen médiocre), l’ensemble des résultats reflétant l’état global du compartiment dans l’estuaire.
Ces actions s'inscrivent dans le cadre des travaux sur l'évaluation des écosystèmes estuariens menés à l'INRAE de Bordeaux.
Les méthodes « lacs et plans d’eau »
Les méthodes de bioindication adaptées aux lacs et plans d'eau sont encore en phase de développement. Jusqu'à présent, peu de protocoles existaient, et aucun n'était compatible avec les prescriptions de la DCE.
A l'heure actuelle, les seules méthodes formalisées pour ces catégories de masses d'eau pour une application dans le cadre de la DCE portent sur les compartiments végétaux (macrophytes et phytoplancton). Celles concernant les invertébrés et les poissons ne sont encore pas définies, ces travaux étant en cours à l'INRAE d'Aix-en-Provence.
Echantillonnage des macrophytes en plans d’eau
Ce protocole a été développé en 2007 par l’équipe phytoécologie de l'Irstea (désormais INRAE) de Bordeaux dans l’objectif de fournir une méthode d’échantillonnage des macrophytes en plans d’eau dans un format standardisé en lien avec la mise en œuvre de la Directive Européenne sur l’Eau. Cette méthodologie s'applique à tous les plans d'eau sur le territoire français dans lesquels les communautés de macrophytes sont considérées comme des indicateurs pertinents au sens de la DCE.
Les macrophytes concernés par ce protocole sont les hydrophytes (algues macroscopiques, ptéridophytes, bryophytes, phanérogames) et les hélophytes "vrais" (hélophytes se développant les pieds dans l'eau).
La mise en œuvre du protocole comporte 3 phases :
- la distribution des unités d’observation (sites d’étude). Un positionnement "théorique" de points situés sur les rives du plan d'eau est déterminé après application du protocole de Jensen (Jensen, 1977) sur une carte ou une photo aérienne ;
- la sélection des unités d’observation. Une sélection de ces points basée sur la description des rives du plan d'eau est ensuite effectuée. Des types principaux de rives rassemblant des descripteurs jugés pertinents pour les communautés de macrophytes, tels que les formations végétales riveraines, les aménagements de rives et la largeur de la zone littorale euphotique sont identifiés dans le protocole et servent de critères pour cette sélection ;
- la structure et réalisation des unités d’observation. Les points retenus sont nommés « unités d’observation ». Ces entités globales d'observation des communautés de macrophytes comprennent des relevés des espèces présentes sur un secteur de rives (100 m de long) et sur 3 profils perpendiculaires aux rives ; sur chaque profil, 30 points contacts, répartis sur une distance maximale à la rive de 50 m, sont réalisés à l'aide d'un aquascope (observation) ou d'un râteau (prélèvement).
Des fiches standardisées de terrain sont disponibles en annexe du protocole.
Ce protocole, mis à disposition des opérateurs, fait actuellement l'objet de la rédaction d'un texte concernant la phase d'échantillonnage, qui devra être soumis à la normalisation. La disponibilité d'une norme expérimentale est prévue en début d'année 2010.
Echantillonnage du phytoplancton
Ce protocole a été développé en 2007 par l’équipe phytoécologie d'Irstea de Bordeaux pour fournir une méthode d’échantillonnage, de conservation et d’observation du phytoplancton en plans d’eau et un cadre d’acquisition des éléments physico-chimiques obligatoirement associés dans un format standardisé en lien avec la mise en œuvre de la DCE. Il s'applique à tous les plans d'eau stratifiés ou non du territoire français.
Ce protocole permet une uniformisation du type de données collectées indispensable à la bancarisation des informations sur le compartiment phytoplancton. Il a été partiellement mis en application par les agences de l’eau en 2007 puis 2008 ce qui permet de constituer un premier retour d’expérience. Les données acquises, actuellement bancarisées par l'Irstea, permettent de développer les nouvelles métriques constitutives du futur indice phytoplancton français.
Dans sa formulation actuelle, ce protocole définit :
- les périodes des campagnes de prélèvements,
- le choix de la station d’échantillonnage,
- les méthodes de prélèvement des échantillons pour la chlorophylle, le phytoplancton et les mesures chimiques en laboratoire,
- la méthode de mesure des paramètres physico-chimique de terrain (sur la colonne d’eau),
- les moyens de conservation des échantillons de phytoplancton et d’eau pour la chlorophylle,
- les règles d’observation et de comptage des taxons de phytoplancton (conformément à la norme Utermölh),
- l’archivage des résultats.
Des modèles standardisés de feuilles de relevés de terrain mais aussi de saisie pour bancarisation sont proposés en annexe de ce document.
Ce protocole fait actuellement l'objet de discussions dans un groupe de travail national, regroupant Irstea, INRA et Ifremer. Un texte concernant la phase d'échantillonnage sera soumis à la normalisation pour une mise à disposition d'une norme expérimentale en fin d'année 2009.
Utilisation des compartiments "invertébrés" et "poissons"
A l'heure actuelle, aucune méthode adaptée à l' évaluation "DCE" des lacs et plans d'eau par ces éléments biologiques n'est disponible en France. Le développement de protocoles est en cours, sur la base de méthodes françaises pré-existantes pour les invertébrés (Indice biologique lacustre, Indice oligochètes, Indice mollusque) ou de méthodes originales ou employées dans d'autres pays européens (poissons).
Les méthodes « rivières »
Pour les cours d'eau, trois éléments sont utilisés pour l'évaluation de l'état écologique : les macroinvertébrés, les macrophytes et le phytobenthos. Dans la pratique, ce dernier élément se focalise sur le peuplement de Diatomées benthiques. A ces trois éléments s'ajoute le phytoplancton, pour les types de cours d'eau correspondant aux grandes et très grandes rivières et aux fleuves.
Les macroinvertébrés : un nouvel indice
Depuis sa normalisation en 1992, l’IBGN (Indice Biologique Global Normalisé – NF T90-350) a été la méthode d’évaluation de l’état écologique, basée sur l’utilisation des macroinvertébrés benthiques, la plus largement employée dans les différents réseaux de mesure et de suivi de la qualité des cours d’eau en France.
La mise en œuvre de la Directive Cadre Européenne sur l’eau (2000/60/CE) impose une évolution de l'IBGN afin de le rendre compatible avec les exigences de cette directive (Circulaire DE/MAGE/BEMA 07/n°4 parue au BO du 11 avril 2007). Un nouveau protocole de terrain a été proposé, testé en 2008 et est en cours de normalisation. Une adaptation de ce protocole de terrain aux grands cours d’eau est également formalisé pour test en 2009.
Les données faunistiques (et mésologiques) obtenues avec les nouveaux protocoles de terrain et de laboratoire seront utilisées dans le calcul d’un nouvel indice "multimétrique" d’évaluation de l’état écologique, qui est en cours de construction. Ce nouvel indice prendra en compte l'écart à la situation de référence, pour une combinaison de métriques taxonomiques et fonctionnelles apportant des informations complémentaires sur la communauté en place.
Jusqu’à la validation de ce nouvel indice multimétrique prévue pour fin 2009, l'évaluation de l'état écologique est obtenue par le calcul d'un score "équivalent-IBGN" à partir d'une partie déterminée des données faunistiques acquises avec le nouveau protocole de terrain. Dans le cadre de la bancarisation des données pour leur traitement en développement de ces nouvelles approches, un modèle de saisie et de transfert est mis à disposition par INRAE (consultez le site dédié hydrobio-DCE). Ces travaux sont menés à INRAE de Lyon, en collaboration avec l'Université Paul Verlaine de Metz.
Le phytobenthos : indice diatomique
L’Indice Biologique Diatomique est une méthode normalisée depuis 2000 (NF T90-354). En 2007, une révision de la norme a permis d’intégrer à la fois une évolution des connaissances taxonomiques et les résultats des recherches récentes en autoécologie (preferenda écologiques des espèces), avec environ 4 fois plus de taxons pris en compte. Cette version intègre également des concepts nouveaux, tels que la considération de taxons exotiques ou invasifs, ou l’utilisation de formes tératologiques pour estimer les pressions toxiques. Cet indice est basé sur l’affectation à chaque taxon d’une cote d’affinité pour des conditions de milieux déterminées. Pour un prélèvement, la somme des cotes spécifiques pondérées par l’abondance de chaque taxon, rapportée à 20, donne une estimation de l’affinité du peuplement dans son ensemble. L’affinité pour des conditions de milieu est calculée par analyse du profil écologique de chaque taxon, à partir d’une base de données comprenant à la fois les listes floristiques et les paramètres physico-chimiques.
Actuellement, le développement de la méthode vise à répondre aux prescriptions de la DCE, en particulier en ce qui concerne l’évaluation des références dans une typologie nationale des cours d’eau, l’amélioration des profils écologiques (en particulier pour les taxons acidophiles), et une meilleure connaissance de la réponse aux pressions toxiques.
Ces travaux sont développés par l'équipe de Phytoécologie à l'INRAE de Bordeaux.
L'indice macrophytique
L’indice biologique macrophytique en rivière est normalisé au niveau national depuis 2003 (NF T90-395). Cet indice, basé sur le même principe que celui utilisé pour le calcul de l’indice diatomique, a été orienté par construction vers l’évaluation du niveau trophique global des cours d’eau. Cette notion englobant la quasi-totalité des pressions, les travaux actuels portent sur la recherche de métriques permettant de distinguer les composantes principales de ce niveau trophique, de manière à améliorer la réponse de l’indice pour les principaux types de pressions (pollution nutritionnelle, organique, hydrologie, morphologie). Un important travail est également en cours pour définir les peuplements et les valeurs de référence pour cet élément biologique, qui n’était jusqu’à présent pas concerné par les mesures sur les réseaux nationaux. Le manque actuel de données et de recul nécessite donc une approche très pragmatique pour que cet élément puisse répondre aux prescriptions méthodologiques qui permettent de l’intégrer de façon opérationnelle dans les programmes d’évaluation.
Le développement méthodologique pour ce compartiment "macrophytes rivières" est assuré par INRAE de Bordeaux.
Le phytoplancton
La prise en compte de cet élément biologique dans les cours d’eau est limitée aux grands hydrosystèmes, dans lesquels ce compartiment végétal peut jouer un rôle important dans le fonctionnement du système.
Toutefois, il a été très peu étudié jusqu’à présent, et les méthodes requises pour son évaluation ne sont pas encore définies. Elles seront probablement dérivées de celles actuellement en cours de mise au point pour les lacs. Ces réflexions sont intégrées au programme du groupe de travail national "phytoplancton lacustre".
L'ichtyofaune : lndice Poissons en Rivières (IPR)
Parmi les indicateurs potentiels, les peuplements de poissons peuvent apporter une information originale en raison de la capacité qu’ont ces organismes à intégrer la variabilité environnementale à différentes échelles spatiales. Dans ce contexte, un programme national d’adaptation d’un indice biotique fondé sur les peuplements piscicoles a débouché sur la mise au point en 2002 d’un premier indice applicable à l’ensemble du réseau hydrographique. Cet indiice a été normalisé en mai 2004 (NF T90-344).
L'adaptation au réseau hydrographique national nécessite la prise en compte des facteurs environnementaux majeurs responsables des variations des peuplements en conditions naturelles et indépendamment de toute pression anthropique. La démarche adoptée repose sur la modélisation de la probabilité d’occurrence sur une station de 34 espèces les plus communes de nos cours d’eau. Ce calcul intègre un certain nombre de variables environnementales locales et régionales (position de la station sur le gradient longitudinal, altitude, vitesse moyenne du courant, conditions thermiques, appartenance à une unité hydrologique). Dans un deuxième temps, d'autres « métriques » fonctionnelles relatives aux peuplements et prenant en compte l’occurrence et l’abondance des espèces ont été sélectionnées sur base bibliographique. Dans un troisième temps, ces métriques ont été modélisées et les résidus standardisés des modèles obtenus ont été utilisés comme valeur des métriques indépendante des facteurs environnementaux.
L’indice multi-paramétrique obtenu est donc basé sur des propriétés fonctionnelles des peuplements, à savoir la structure trophique, les modes de reproduction, la tolérance aux perturbations, les préférences écologiques.
Sur la base de ce premier outil, un nouvel indicateur est actuellement en développement. Il prendra en compte les acquis les plus récents obtenus lors de programmes européens et cherchera à intégrer des métriques prenant en compte les classes de taille. L’outil devrait être disponible en 2010.
Les méthodes « rivières »
La prise en compte systématique de la "qualité de la donnée" est une notion nouvelle dans les applications hydrobiologiques. Elle est désormais imposée par la DCE, reprise et précisée par les textes nationaux, dont le Schéma National des Données sur l'Eau (SNDE). Aquaref est chargé de définir le périmètre et les principes de l'application de ces concepts dans les méthodes actuellement développées.
Cette intégration concerne tous les aspects le la mise en œuvre des protocoles :
- définition de protocoles susceptibles de supporter formellement une démarche qualité,
- phasage des protocoles en types d'approche homogènes (définition de stations, échantillonnage biologique, travaux de laboratoire, détermination taxonomique et validation de listes floristiques et faunistiques),
- identification des sources d'erreur et évaluation des incertitudes,
- préconisations opérationnelles d'encadrement des protocoles, outils standardisés de saisie et de transmission des données,
- participation à la normalisation et aux propositions d'éléments pour l'accréditation.
Ces actions s'inscrivent à la fois dans le cadre du développement de méthodes nouvelles et dans celui de l'objectif final d'utilisation des résultats.