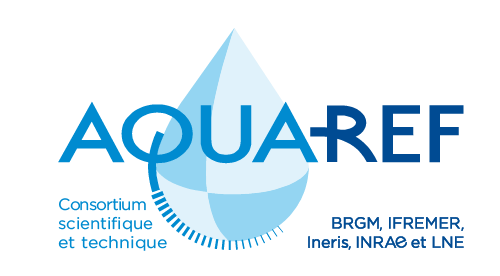À propos d'AQUAREF
Historique
Les milieux aquatiques font l’objet, en France métropolitaine et dans les DROM, d’une surveillance croissante depuis la loi sur l’eau de 1964, à l’origine de la mise en place des premiers réseaux de surveillance, avec deux axes forts : la chimie en premier lieu et, dans un second temps, l’hydrobiologie. La directive cadre européenne sur l’eau (DCE) du 23 octobre 2000 a marqué un tournant important en faisant de la surveillance un pilier de la politique de l’eau sur lequel reposent l’évaluation de l’état des eaux et le suivi de son évolution. Ce principe a par la suite été repris par la directive cadre stratégie pour le milieu marin (DCSMM) en 2008.
La qualité des données de surveillance est devenue un enjeu central : les données doivent être fiables, comparables, accessibles, interprétables et permettre un rapportage répondant aux exigences européennes. En France, leur acquisition repose sur un processus mobilisant de multiples acteurs (pouvoirs publics, OFB, agences et offices de l’eau, DREAL et DEAL, établissements publics opérateurs de surveillance, laboratoires universitaires, bureaux d’études et laboratoires privés, …). Elle est basée principalement sur des marchés publics, ce qui rend indispensable la mise en place de règles partagées et harmonisées.
C’est dans ce contexte qu’est né le consortium AQUAREF en 2007, à la suite du rapport de l’Inspection générale de l’environnement de juillet 2006, préconisant la création d’un laboratoire de référence pour assister les autorités publiques et les opérateurs pour la définition et la mise en œuvre des programmes de surveillance prévus par la DCE. La volonté conjointe des 5 établissements publics (BRGM, Ifremer, INERIS, Cemagref‐aujourd’hui INRAE, LNE) et de la direction de l’eau (DE) du Ministère en charge de l’écologie, était de mettre en œuvre un dispositif centré sur l’expertise collective, offrant à l’Etat français les garanties d’une meilleure maîtrise de la qualité des données de surveillance des milieux aquatiques produites par les opérateurs et un socle de connaissances pour interpréter les données.

║ Consulter la plaquette de présentation Aquaref
Missions et orientations stratégiques
La création de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema – aujourd’hui OFB) a été concomitante à celle d’Aquaref. La mise en place du schéma national des données sur l’eau (SNDE) en 2010 est venue conforter le rôle d’Aquaref aux côtés de celui de l’Onema dans le dispositif national de surveillance comme référent pour la proposition de méthodologies communes. En 2018, un nouvel arrêté positionne Aquaref au cœur de la gouvernance associée au SNDE (article 6) en tant que « support technique » du Système d’Information sur l’Eau (SI Eau) pour l’élaboration du référentiel technique (RT) pour la surveillance des eaux, dont l’OFB assure la coordination.
Le consortium Aquaref exerce ce rôle en s'appuyant sur une gouvernance interne et externe et sur des documents structurants. Depuis sa création, Aquaref a été doté de plusieurs plans stratégiques définissant les principales orientations pluriannuelles pour mener à bien les grandes missions confiées au consortium par les pouvoirs publics, à savoir :
- Elaborer des règles relatives aux processus de prélèvement, de mesure, et d’analyse afin de fiabiliser la qualité des données de surveillance et organiser leur transfert ;
- Constituer une force de proposition pour l’anticipation des évolutions de la surveillance ;
- Appuyer les pouvoirs publics dans les groupes d’experts techniques nationaux et européens.
Le plan stratégique pluriannuel d'Aquaref est co-signé par la directrice de l'eau et de la biodiversité du ministère en charge de l'environnement, le directeur général de l'OFB, le président d'Aquaref et les 5 directrices et directeurs généraux des établissements membres du consortium.
Les orientations stratégiques sont traduites opérationnellement dans un programme scientifique et technique pluriannuel, qui fait l'objet d'une coopération avec l'OFB. Le ministère et, depuis sa création, l'Onema, puis l'AFB et l'OFB soutiennent techniquement et financièrement les travaux d'Aquaref et la coordination nécessaire pour proposer et s'assurer de la mise en œuvre d'un programme répondant aux besoins de la surveillance.
║ Consulter le plan stratégique
Le site internet Aquaref et la toile eaufrance
Le site internet constitue un élément central pour le transfert et la valorisation des productions d'Aquaref vers les différents utilisateurs.
En tant que site du portail eaufrance du Système d'information sur l'eau (SI Eau), il a également vocation à diffuser les référentiels et méthodes validés qui entrent dans le périmètre d'intervention d'Aquaref au titre du Référentiel Technique du SI Eau. C'est dans cet objectif que le site dispose d'un menu "Référentiel Technique" afin de faciliter la recherche de ces éléments.
En bref, AQUAREF c'est...
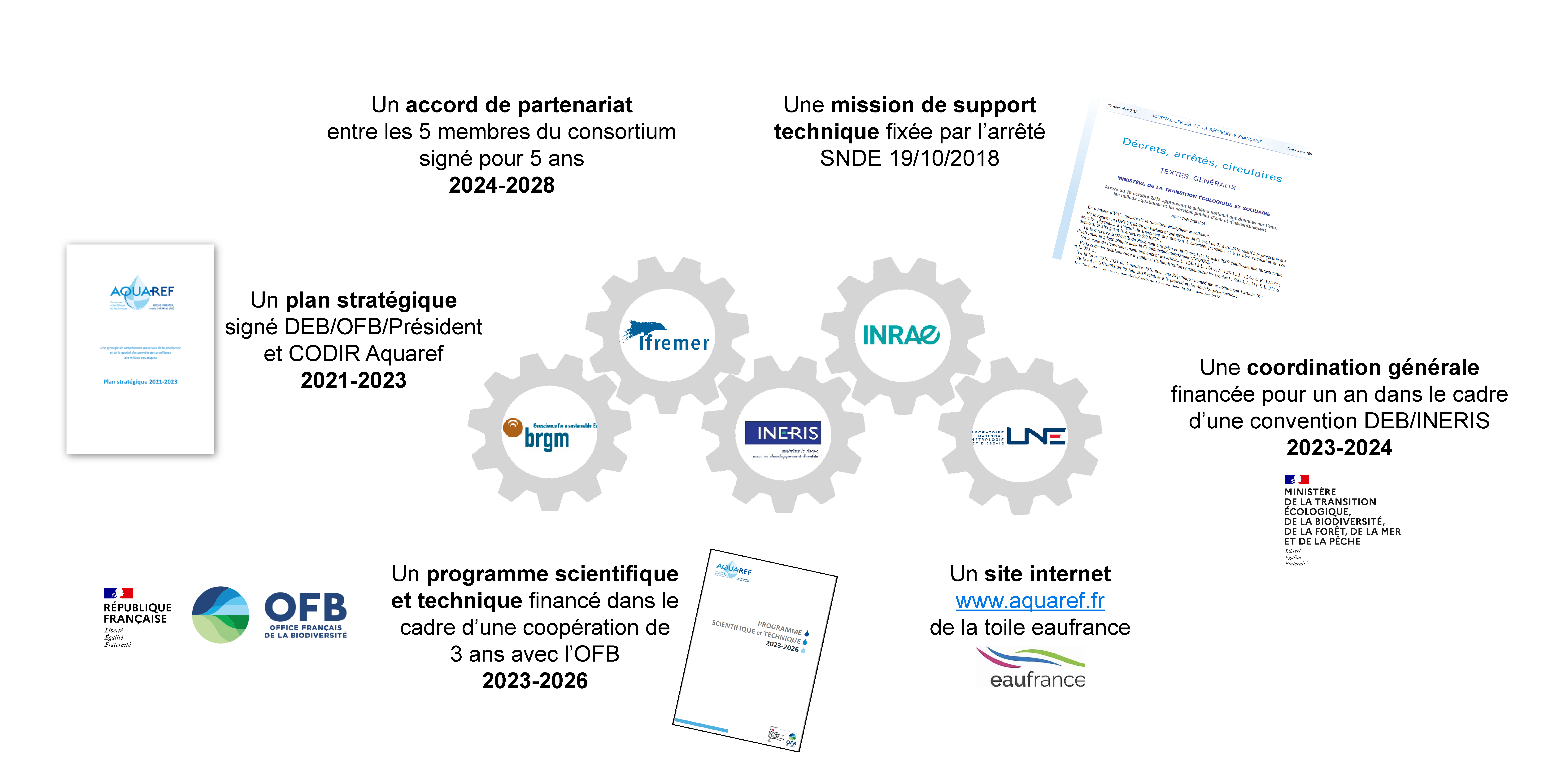
Le consortium Aquaref
Présidence
Patrick Flammarion, président d'Aquaref, directeur général délégué Expertise & Appui aux politiques publiques de l'INRAE
Direction du programme
Lauriane GREAUD, directrice du programme
Cécile LEVASSEUR, assistante de la direction du programme
Etablissements membres du consortium
Le BRGM et les eaux souterraines
Le BRGM a pour objectifs d'apporter une réponse pluridisciplinaire et systémique aux enjeux d’accessibilité et de disponibilité des ressources en eaux souterraines et de connaissance de leurs interactions avec les autres compartiments du grand cycle de l'eau face aux pressions anthropiques et climatiques, afin d'accompagner l’adaptation et la résilience des territoires. Pour ce faire, la direction de l'eau du BRGM mène des activités de R&D et d’accompagnement des politiques publiques et des industriels de l'eau. Ses principaux objectifs sont de :
- coordonner, en interaction avec les directions régionales, la surveillance des eaux souterraines en France via le réseau piézométrique national,
- renforcer la connaissance et la modélisation des processus bio-physico-géo-chimiques en vue d'assurer la préservation tant qualitative que quantitative des aquifères ainsi que des cours d'eau et écosystèmes qui leur sont associés,
- produire, gérer et valoriser les informations et connaissances relatives aux eaux souterraines,
- développer des méthodes d’aide à la gestion intégrée des systèmes aquifères (incluant les dimensions socio-économiques).
Pour la bonne réalisation de ces objectifs, le BRGM est doté de laboratoires dont une partie des activités est réalisée sous accréditation COFRAC. Ces laboratoires permettent d'effectuer les développements analytiques nécessaires à la caractérisation chimique des milieux environnementaux que ce soit pou les micropolluants organiques ou inorganiques.
L’IFREMER et les eaux côtières et marines
L’Ifremer, organisme de recherche et de développement technologique finalisé est chargé d’améliorer les méthodes de surveillance, de prévision d’évolution, de protection et de mise en valeur du milieu marin et côtier.
Les besoins de surveillance sont définis par des politiques publiques, essentiellement construites à l’échelle européenne, que ce soit la surveillance environnementale liée à la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) et le paquet hygiène pour la surveillance sanitaire des produits de la mer.
La Directive cadre stratégie pour le milieu marin 2008/56/CE (DSM) met en place un cadre visant à réaliser ou maintenir un bon état écologique du milieu marin (de la côte aux limites des zones économiques exclusives) des mers européennes.
La mise en œuvre des différentes politiques nationales de surveillance des eaux littorales s’appuie sur les réseaux de surveillance mis en place par l’Ifremer.
www.ifremer.fr
L'INERIS et les risques que font peser les activités économiques et les substances chimiques mises en œuvre sur les milieux aquatiques et terrestres
L'INERIS a une grande expérience en matière d’appui technique aux pouvoirs publics pour la caractérisation et la surveillance des rejets issus des activités humaines ainsi que l’évaluation et la maîtrise de leurs impacts sur l’environnement. L’expertise développée permet d’apporter une vision intégrée des contaminants d’intérêt associés aux activités humaines et aux nouveaux enjeux liés notamment à la transition énergétique et écologique. Le développement de stratégies de surveillance couplant des outils d’analyses chimiques et biologiques (ou de biosurveillance) contribue à améliorer la caractérisation de la qualité des milieux et des rejets. L’Institut complète ces compétences par l'étude des effets des substances toxiques à faibles doses sur les écosystèmes et la santé humaine (en particulier les substances ayant des effets de perturbation endocrine) et l’élaboration de valeurs écotoxiques de référence utilisées pour l’évaluation de l’état chimique des eaux (disponibles sur le PSC).
INRAE et les eaux superficielles
Comment hiérarchiser les effets de l’homme sur la qualité des cours d’eau et des plans d’eau, alors même que ces derniers sont des milieux complexes, soumis à une forte variabilité hydrologique, aux multiples influences humaines et plus globalement au changement climatique ? Par des étapes de modélisation de sous-ensembles de l’écosystème, l’approche scientifique permet de développer notre capacité à prévoir l’effet d’une action de restauration ou, à l’opposé, à anticiper une menace sur la qualité écologique des masses d’eau.
Les travaux d’INRAE visent à préparer la mise en œuvre de la Directive Cadre sur l’Eau, tout en conservant un équilibre entre recherches propres, assemblage de connaissances et transfert aux acteurs de la société. Les recherches se consacrent à l’établissement de modèles liant pression et impact, à évaluer la variabilité interannuelle naturelle, à mettre au point des bioindicateurs et à identifier des indicateurs de l’état physique des milieux aquatiques.
Le LNE : référence nationale en matière de métrologie
Parmi ses missions de service public, le LNE se doit de :
- développer et maintenir les étalons nationaux ;
- anticiper les besoins nouveaux en matière de mesure et d'essais, liés aux évolutions technologiques et aux attentes nouvelles de la société dans les domaines de la sécurité, de la santé, de la qualité et de la protection de l'environnement ;
- donner une assistance technique aux pouvoirs publics et aux acteurs économiques pour l'élaboration de nouvelles réglementations et normes aux niveaux international, européen et national, la mise au point de nouvelles méthodes d'essais, et la surveillance du marché.
Ainsi, le LNE dispose d’outils métrologiques permettant de répondre aux défis de la qualité spatio-temporelle des données et développer des méthodes de référence afin de :
- Soutenir les infrastructures de surveillance de la pollution environnementale,
- Améliorer les observations pour la compréhension et l'évaluation du changement climatique et des cycles biogéochimiques.
De par ses activité, le LNE permet d’établir la traçabilité métrologique et donc la comparabilité des résultats de mesure, dans le domaine de la surveillance de la qualité de l’eau au sein d’Aquaref.